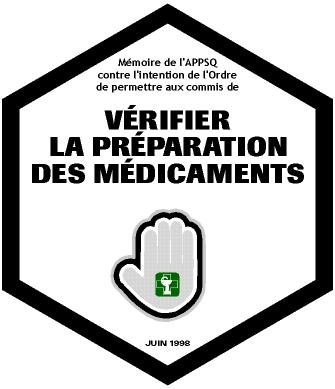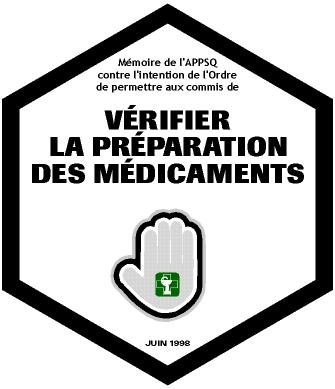
Introduction
L'Association professionnelle des pharmaciens salariés (APPSQ)
représente les 2339 salariés de pratique privée membres de
l'Ordre, soit 61,9 % des praticiens du secteur privé et 41,4 % de
l'ensemble des effectifs de la Corporation professionnelle.1 Le
travail des salariés de pratique privée est intimement lié à la
distribution des médicaments ; en effet, chaque année, les salariés
sont responsables de la préparation de millions d'ordonnances
dispensées de manière sécuritaire au public québécois.
Aussi avons-nous été surpris d'apprendre que l'Ordre des
pharmaciens entend permettre la délégation, à des commis, de la
tâche de vérification de la conformité contenant-contenu lors de la
préparation des médicaments.
S'assurer que le patient reçoit bien le bon médicament est une
parmi plusieurs vérifications qu'effectue le pharmacien lors de
l'exécution des ordonnances et la principale lors du renouvelle-
ment. Concrètement, c'est celle sur laquelle il attache le plus
d'importance. Pour des raisons de clarté dans le présent mémoire,
nous parlerons de la vérification de la préparation des médicaments
comme étant synonyme de la «vérification de la concordance
contenant-contenu».
Pour l'instant, l'Ordre entend permettre une délégation précise,
bien encadrée, dans le secteur public. Mais une fois le principe
adopté, on voit mal comment une délégation analogue pourrait être
refusée en pratique privée. Dans ce sens, nous sommes surpris de
ne pas avoir été consultés et désirons par la présente vous faire
part de notre plus vive opposition à ce projet.
Les besoins de la société québécoise
Dans certains milieux, la simple préparation des médicaments est
considérée comme une tâche bas de gamme mettant à profit peu
de chose de l'expertise du pharmacien, et accaparant trop de son
temps. Toutefois, si on enlève au pharmacien des tâches qui
représentent une partie importante de son activité professionnelle,
on doit s'assurer que le temps ainsi libéré peut raisonnablement
être meublé de tâches plus sophistiquées, à défaut de quoi les
besoins en pharmaciens de la société québécoise devront être
réévalués à la baisse.
En effet, toute transformation radicale du rôle du pharmacien
doit se faire à la lumière des besoins du public et de la capacité de
la société québécoise à payer pour les actes accomplis par les
pharmaciens. Or à notre connaissance, aucune étude sérieuse n'a
jamais été entreprise à ce sujet au Québec. Dans un tel contexte, il
nous semble irresponsable de déléguer une tâche aussi importante
que la vérification des médicaments à des commis sans connaître
les conséquences qu'une telle décision entraînera.
S'il est possible de réduire le travail du pharmacien instrumentant
à la simple autorisation de la préparation des ordonnances, inévita-
blement quelqu'un, quelque part, basera l'organisation du travail
sur ce rôle minimaliste. On peut donc craindre une guerre des
honoraires alimentée par les économies d'échelle que rend possible
cette délégation.
Dans le contexte économique actuel, offrez au public québécois
la possibilité de payer moins cher pour ses médicaments, et aveu-
glément il choisira d'économiser dans la grande majorité des cas.
En d'autres mots, au lieu de libérer le pharmacien de tâches bas de
gamme, le rendant disponible à se consacrer à des actes plus
valorisants, nous craignons que la délégation de la vérification aux
commis n'entraîne au contraire une industrialisation encore plus
grande de la distribution au détail des médicaments.
Alors que les grandes chaînes de pharmacies se livrent
actuellement à une surenchère quant à la qualité de leurs services,
cette délégation risque de les entraîner malgré elles vingt ans en
arrière, à l'époque des guerres de prix aveugles. Dès qu'une chaîne
cédera à la tentation de se transformer en usine à pilules pas
chères, le moindrement que s'accroîtra sa part du marché, les
autres chaînes n'auront pas d'autres choix que de l'imiter puisque
ce sera apparemment une recette gagnante.
Si vous rêvez à l'effet positif de cette délégation chez une
poignée de pharmaciens d'avant-garde qui seraient en mesure
d'être plus interventionnistes une fois libérés de la corvée de la
préparation des médicaments, réveillez-vous : vous perdez de vue
que ce n'est pas chez ces praticiens que s'expriment les besoins
de la grande majorité du public.
De plus, pourquoi la Régie paierait-elle pour des actes posés par
des pharmaciens quand ces actes pourraient être accomplis à
moindre coût par des commis ? On peut donc craindre une
réduction des honoraires versés par la Régie au chapitre de la
préparation des médicaments ou une plus grande difficulté pour
l'AQPP à justifier ses demandes d'honoraires.
Quant aux pharmaciens d'hôpitaux, s'ils ont de la difficulté à
accomplir tout ce qu'on exige d'eux dans le contexte actuel, nous
craignons qu'une fois passée l'ère des restrictions, l'État ait
tendance à favoriser l'embauche de commis et non de pharmaciens
dans le secteur public, accroissant l'importance de la pratique
privée comme débouché principal des diplômés en pharmacie.
De plus, dans les centres hospitaliers de soins de longue durée,
nous craignons que les pharmaciens travaillant sur place aient
plus de difficulté à justifier leur emploi face aux usines de cartes
monoalvéolées très peu coûteuses que pourraient mettre sur pied
des collègues entreprenants du secteur privé. Dans un contexte de
restrictions, les arguments relatifs à la qualité des soins ont un
impact limité sur les gestionnaires.
Les répercussions de la délégation de la vérification aux commis
sont vastes et c'est pourquoi nous trouvons irresponsable d'y
donner suite sans étude d'impact et sans consultation avec les
principaux intéressés que sont les praticiens du secteur privé.
L'état de la profession
Parallèlement à un accroissement des responsabilités du
pharmacien, nous assistons au Québec depuis trente ans à une
industrialisation de la distribution au détail des médicaments.2
Alors qu'une pharmacie préparant 120 ordonnances par jour, était
considérée achalandée il y a trente ans, aujourd'hui le public reçoit
ses médicaments d'entreprises commerciales s'appuyant sur un
volume d'ordonnances considérablement plus élevé.
Cette industrialisation atteint présentement ses limites. Plus on
accroît la cadence de travail, plus il devient difficile de maintenir
une organisation du travail qui respecte la qualité des soins. Non
seulement assistons-nous à une diminution des interventions du
pharmacien auprès des prescripteurs (à nombre d'ordonnances
égal)3 mais l'information au public devient moins systématique et,
de manière générale, l'usurpation des tâches du pharmacien
s'accentue.4
Les résultats préliminaires de notre enquête salariale de cette
année, portant sur la vérification du travail effectué par des aides
techniques, de la prise en note des ordonnances des prescripteurs
par des commis et des conseils relatifs aux médicaments d'ordon-
nances communiqués par des préparateurs, nous incitent à croire
que les dirigeants de l'Ordre ne sont sans doute pas bien informés
de ce qui se passe réellement en pratique privée et des mesures à
prendre pour améliorer la situation.
Puisque le service du syndic n'effectue plus d'enquêtes au
hasard, et que le Service d'inspection ne visite en moyenne les
pharmacies qu'à tous les 5 à 8 ans, il n'est pas surprenant que
l'Ordre soit peu informé de l'ampleur de la délégation actuelle des
actes professionnels aux commis, qui vont bien au-delà de ce que
l'Ordre permet déjà.
La Corporation professionnelle est à ce point mal informée de ce
qui se passe réellement en pratique privée et tellement peu en
mesure de réprimer les abus possibles de ses décisions, qu'il nous
apparaît téméraire de sa part de provoquer un bouleversement
aussi important que de permettre aux commis la vérification de la
préparation des médicaments.
Il y a plus de trente ans, l'Ordre avait laissé les commis s'occuper
de l'exécution des ordonnances en absence de pharmacien.
Lorsque l'Ordre s'est rendu compte de son erreur, les commis
réclamèrent un droit acquis. L'Ordre a pu rétablir la situation parce
qu'il n'avait jamais reconnu officiellement de droit aux commis.
Aujourd'hui, reconnaissez-leur un droit de s'occuper de presque
toutes tâches reliées à la préparation des médicaments et ne soyez
pas surpris si le Législateur devait vous imposer une nouvelle
catégorie de membres, soit les préparateurs en pharmacie, diplô-
més des CEGEP, à l'instar de ce qui s'est passé à l'Ordre des
infirmières et à l'Ordre des ingénieurs.
La surveillance cyclique
En adoptant le rapport du Comité ad hoc à ce sujet, l'Ordre
adopterait le principe de la surveillance cyclique (i.e.– vérifier par
«spot checks»). Dans le cas de la délégation à des aides
techniques dans le secteur public, la fréquence du cycle serait
laissée à la discrétion du pharmacien-chef. En d'autres mots, on
pourrait vérifier une prescription sur mille ou sur un million, vérifier
une ordonnance par jour ou par année, selon le bon vouloir du
pharmacien-chef.
Transposé en pratique privée, cela signifie qu'on pourrait laisser
des commis s'autovérifier entre eux, à la condition d'effectuer des
«spot checks» à la fréquence laissée à la discrétion du pharmacien-
propriétaire.
Nous ne voulons mettre en doute le jugement professionnel de
nos collègues du secteur public, ni celui de nos collègues
propriétaires, en général. Toutefois, on doit prendre conscience
que la permission d'effectuer une surveillance cyclique facilite
grandement le fonctionnement des pharmacies postales, aux
dépens de la qualité des services dispensés au public.
S'il suffit à un pharmacien de vérifier une ordonnance de temps
en temps, selon son caprice, on imagine facilement qu'une
entreprise de pharmacie postale, propriété d'un pharmacien
québécois, pourrait à elle seule exécuter une quantité d'ordon-
nances inimaginable autrement.
Nos collègues du secteur public doivent être conscients que si
l'Ordre permettait la surveillance cyclique, cela ouvrirait la porte à
des abus importants dans le secteur privé.
Quant aux exigences relatives à la formation du personnel,
destinées à assurer la sécurité du public dans le cadre d'une
surveillance cyclique, comment peut-on les prendre au sérieux ?
L'Ordre a déjà un règlement qui précise le nombre minimal
d'années d'expérience des commis travaillant au laboratoire des
pharmacies. À notre connaissance, jamais personne n'a été
poursuivi en vertu de ce règlement et tout le monde s'en moque
depuis vingt ans. Peut-on imaginer qu'une simple norme de l'Ordre
(n'ayant pas force de loi) aurait plus d'impact qu'une disposition
législative ?
La responsabilité du pharmacien
Dans tous les cas, le pharmacien salarié demeurera responsable
de ce qui se passe lorsqu'il est en service. En cas d'erreur, même
si les médicaments ont été préparés par des commis et vérifiés par
eux, le salarié demeure responsable. En clair, il sera responsable
des erreurs qu'il n'a pas commises et qu'il n'était pas en mesure
d'empêcher.
Puisque le salarié ne choisit pas les commis avec lesquels il
travaille, ni la cadence de travail à laquelle il est soumis, en cas
d'erreur, l'Ordre pourrait poursuivre le salarié conjointement avec
le propriétaire ou dans certains cas, ne poursuivre que le
pharmacien-propriétaire. C'est ce qui se produit aux États-Unis,
mais qui n'arrive jamais au Québec. Ici, le pharmacien en service
est toujours le seul coupable.
Dans une décision récente rendue le 5 novembre dernier, le
Comité de discipline de l'Ordre condamnait un salarié à payer 2 000 $
pour une erreur dans l'exécution d'une prescription. Dans cette
pharmacie, le salarié devait préparer 400 à 600 ordonnances par
jour, aidé de 3 commis et de 2 postes de travail. Contre-interrogé
par l'avocat de l'Ordre, le salarié était forcé d'avouer que «seule-
ment» 330 prescriptions ont été exécutées ce jour-là.
Malgré que le salarié ait déclaré sous serment que son patron lui
impose des conditions qui mettent en péril la protection du public,
et que cette déclaration n'ait été contredite par personne, dans son
jugement le Comité de discipline «déplore qu'un professionnel
expose (i.e.– révèle) ainsi être tenu de pratiquer dans des
conditions dangereuses. Toutefois, c'est là la responsabilité du
pharmacien : il ne doit pas accepter de travailler en des telles
conditions. L'intimé (i.e.– le salarié) est seul responsable de la
faute admise». Non seulement le salarié est-il le seul responsable
de l'erreur mais les juges lui reprochent même d'en avoir révélé la
cause profonde.
Ce jugement est d'autant plus choquant que le pharmacien-
propriétaire, qui avait ignoré apparemment les voeux pieux de
l'Inspection professionnelle d'embaucher un 2e pharmacien, n'a
pas été inquiété par l'Ordre et n'a pas été poursuivi par le syndic.
En fait, aucun pharmacien-propriétaire n'a jamais été poursuivi par
l'Ordre pour avoir fait travaillé son personnel dans des conditions
dangereuses pour le public.
Le message de l'Ordre est clair : ôtez aux salariés le moyen de
s'assurer que le patient reçoit le bon médicament, augmentez la
cadence de travail et si jamais il y a des erreurs, nous continuerons
à taper sur les salariés et à en faire les boucs émissaires aux yeux
du public.
Pour le salarié, la vérification de la conformité contenant-
contenu, est son seul moyen de vérifier le travail accompli par les
aides techniques et de s'assurer que le patient recevra le bon
médicament. C'est également par ce moyen qu'il autorise le
médicament à être remis au patient. Ce qui ne semble extérieure-
ent qu'une simple formalité, est en fait l'instant de sa prise de
responsabilité.
Privé du seul moyen de s'assurer que le patient recevra le bon
médicament, le sort du pharmacien salarié devient entre les mains
des commis avec lesquels il travaille. Là où les relations sont
tendues, le salarié n'a pas ce pouvoir de congédiement qui impose
le respect des subalternes. Si ces derniers veulent se débarrasser
d'un pharmacien salarié, ils n'ont qu'à se liguer pour commettre
une série d'erreurs inoffensives et lui faire comprendre qu'il aurait
intérêt à chercher un emploi ailleurs.
Conclusion
La préparation des médicaments, la prise en note des ordonnances
de médecins, le transfert des ordonnances, les conseils aux
patients relatifs aux médicaments d'ordonnances, la remise du
médicament, de même que la vente des médicaments de vente
libre, sont déjà accomplis par des commis dans de nombreuses
pharmacies. Une des rares formes apparentes d'autorité du
pharmacien salarié sur ces commis était qu'aucun médicament
d'ordonnance ne pouvait être remis au patient sans la vérification
du pharmacien instrumentant.
Dans un tel contexte, la délégation de la vérification des
médicaments correspond à une marginalisation apparente du rôle
du pharmacien salarié. Même si ce dernier devrait en profiter pour
rédiger des opinions pharmaceutiques, des refus, ou pour
s'impliquer dans la prescription de médicaments homéopathiques,
il se placera sur une voie d'évitement, en position apparemment
complémentaire au travail des commis. Cela compliquera d'autant
l'exercice de son autorité auprès d'un personnel qu'il n'a pas
choisi, qu'il n'a pas formé, et sur lequel il exerce une autorité
parfois basée sur un consensus fragile.
De plus, s'il est souhaitable que les dirigeants de l'Ordre aient
une vision futuriste de notre profession, nous nous opposons à ce
que nos membres et le public fassent les frais des bouleversements
que la réalisation d'une telle vision entraînera.
Tant que nous ne serons pas en mesure de rassurer nos
membres quant à l'impact de cette délégation pour eux, l'APPSQ
tient à réaffirmer son opposition totale à la délégation de la
vérification de la préparation des médicaments à des commis.
Références
1– Anonyme. Rapport annuel 1997-1998. Montréal : Ordre des pharmaciens du Québec. 1998.
2– Martel JP. Le sens de l'évolution professionnelle récente, en pratique privée. Le Phar-
macien 1978 ; 52 (mai) : 21-4.
3– Martel JP. Salaires'94 - Résultats de l'enquête salariale de l'APPSQ de mai 1994. Montréal :
APPSQ. 1994.
4– Dubois R et Martel JP. Résultats de l'enquête salariale de l'APPSQ - Salaires'95. Montréal :
APPSQ. 1995.
Retour au menu antérieur